Une maison d’hébergement
Autrefois, ce fut une maison familiale, ancienne ; On dit aussi qu’elle a abrité des fugitifs pendant la guerre. Elle se tient dans la cité, en bordure d’une voie ferrée, entre un jardin et une rue, dans la proximité des bus, des supermarchés, des fast-foods. À l’intérieur, le mobilier, les portes sans cesse réparées, encaissent coups de pied et colères ; les cris et le tumulte résonnent entre les murs.
C’est une maison de passage où se déposent les errances, les peurs, les abandons. Elle demeure pourtant, singulièrement, au delà des fracas, une maison d’accueil.
Vivent ici six jeunes garçons et filles, déjà grands, entre 15 et 18 ans, qui ne trouvent refuge nulle part ailleurs. Il y a une règle instituée :
« De cette maison, ils ne seront pas exclus, pendant au moins une année, souvent deux. « Cela malgré des comportements très violents, très attaquants appelant habituellement le rejet hors des institutions spécialisées.
C’est ainsi que nous aurons le temps de faire connaissance avec eux, et eux avec nous, les éducateurs et les soignants .
Nous sommes ensemble embarqués dans cette rencontre ; c’est un lieu d’accueil dit expérimental, destiné à ces adolescents qu’on dit « incasables ».
Voilà donc un lieu mouvant, tantôt habité, tantôt vacant, l’ambiance y est changeante, de la musique aux cris, du rire à la violence, instable, imprévisible toujours.
Les objets épars disent le désordre adolescent, la fin de l’enfance, et aussi le désarroi, l’abandon, la confusion, la violence.
Ici, les jeunes partent et reviennent, détruisent, puis exigent réparation de tout. Ils guettent des regards, des attentions extrêmes, une improbable consolation, pour refuser tout, ensuite, farouchement… Alors, Ils fuient éperdument dans la ville, en espérant qu’on les retienne ou qu’on dira leur absence.
Entre nous
Nous ne sommes pas dans un hôpital, ni dans un centre éducatif fermé. Il nous faut laisser là nos représentations anciennes. « pourquoi des psy ici? nous ne sommes pas fous! »C’est une expérience ardue, une remise en question de notre pratique, de la légitimité de notre présence de cliniciens immergés dans ce lieu où s’entrecroisent l’intime du quotidien et la dimension thérapeutique.
Par quelle alchimie convertir ce qui obstinément va vers la violence , en lien social humanisé?
Comment être ensemble un instant, fabriquer cet » entre nous » qui est la pierre angulaire du travail thérapeutique? Tout discours éducatif et psychologique est ressenti ici comme une agression. la novlangue des « jeunes de foyers » circule, passant du babil enfantin au langage obscène, et c’est dans ce bruit de mots qu’éclatent brutalement des fulgurances poétiques.
Pour les soignants( psychiatres ou psychanalystes) il s’agit de se mêler aux jeunes et aux éducateurs dans un espace de vie commun; Le bureau n’est occupé que rarement, il sert de remise pour de vieux livres de la dernière guerre.
Notre présence est là, précaire, fragile, dans ce nouage de la vie quotidienne à un projet éducatif et thérapeutique, dans un cadre instable.
Nous vivons là une expérience de « l’informe », difficile à saisir. Nous nous tenons sur un appui interne du corps, une simple présence affirmée, sans réponse immédiate, ouverts à ce qui advient. Pourtant nous sommes gagnés par une hyper vigilance physique et psychique ,et une tension musculaire épuisante.
Ces adolescents ont été confrontés pour la plupart, dans le premier âge, à la violence extrême des abandons, des guerres, des déplacements de population, à la déliaison des liens de filiation, à la mélancolie des mères et à l’humiliation des pères. Ils ont subis ou ont été témoins de violences irreprésentables à cet âge du petit.
Ainsi la parole adressée par un adulte, véridique, est toujours mise à l’épreuve. Parler ensemble , au bord de ces aires d’effondrement symbolique, est risqué, suspect. Les visages se cachent sous les capuches, les regards guettent alentour. Cette hyper vigilance, ne les quitte pas. Nous sommes dans un contexte de survie, tendus, toujours. La possibilité de la catastrophe imminente doit être tenue à distance, maitrisée, ou anticipée par l’excitation ou l’agitation. Ces cris, ces rires sont autant de défenses contre la possibilité du pire, et cette possibilité nous atteint, nous aussi.
Persévérer dans la crise?
Nous avons vu l’un ou l’autre adolescent se métamorphoser brutalement, happé par les figures anciennes, archaïques, hallucinées, féroces, hors du temps. Nombre d’éducateurs ont décrit ce moment où le regard de l’adolescent bascule, où le visage disparaît, où le face à face se refuse.
Le jeune est alors habité de toute puissance, aucune parole ne peut l’atteindre, il est emporté par la résurgence d’un vécu ancien, qui le domine et le défigure, jusqu’à l’hallucination ; Lui revient au présent, sur la scène institutionnelle, le trauma passé. Transe guerrière, pour exorciser la peur, possession diabolique d’un autre âge ; les mots eux même pour dire ces états du corps renvoient aux temps primitifs, ou au Moyen âge.
Sur une telle scène violente , les notions de temps présent ou passé coexistent, il peut y avoir un « moment psychotique transitoire », au sens où réel et imaginaire semblent fusionner momentanément.
Cette poussée hallucinatoire se présente à l’endroit d’une discontinuité, du trou noir de la mémoire consciente. Là où une zone psychique cicatricielle réclamerait justice.
L ‘adolescent, retranché dans la violence, se débat dans ce passé traumatique avec ces émotions extrêmes, l’effroi, le sans visage, le sans nom.
Les menaces d’anéantissement psychique se retournent en pulsion meurtrière. L’adolescent s’en prend alors à l’adulte présent, lui-même fortement déstabilisé dans ses repères de temps et d’espace.
Risquer le corps à corps ?
Contenir un adolescent en furie demande une grande force psychique .
Une telle violence expose à une violence symétrique, en miroir, avec un climat sacrificiel, dangereux.
Le risque est, pour un soignant, de se trouver débordé par ses émotions, ses propres vécus anciens, ceux qu’il ignore de lui-même. Il y a pour chacun un vertige psychique à se tenir à proximité de ces zones traumatiques, à supporter la force d’une relation transférentielle psychotique momentanée, sans le savoir, et à entrer alors dans une symétrie dangereuse.
C’est dans ce passage, ce retour monstrueux d’un temps archaïque, qu’il faut trouver le courage de poser un acte fort, physique, un geste chaste et contenant, dans les bras, avant que se murmurent les paroles inventées, puis parfois les bercements …comme avec un petit.
C’est comme cela que revient parfois, dans les larmes, le temps présent et le visage de l’enfant retrouvé. Cela peut parfois durer des heures et se répéter jusqu’à épuisement.
Agrippement et attachement, liens précoces?
Nous percevons, dans l’après coup de ces évènements, ce que le nourrisson d’alors a vécu, sans mots pour symboliser, sans représentation possible, figurable, du traumatisme. Il est resté sidéré par des affects trop forts qui ont tracé des sillons brûlants dans l’organisation pulsionnelle, où se mêlent la jouissance et l’horreur. Il n’a pu intégrer de tels vécus perceptifs, qui perdurent comme expériences sensorielles étranges. Il doit sa survie psychique au processus interne de clivage, au déni, pour ignorer la douleur, annuler l’angoisse. Le sujet en paye le prix souvent par un sentiment d’étrangeté, de retrait de son corps, d’inconsistance. La survie n’est pas la vie … Ces constructions, ces barrages, un jour ou l’autre se fissurent. Ils ne résistent pas aux remaniements psychiques de la puberté.
Le retour de ces figures archaïques, retour infiniment attendu et redouté, se manifeste le plus souvent dans les temps de l’intime, dans les nécessaires rapprochements physiques, au foyer d’hébergement. Elles surgissent au moment du coucher, du lever, du repas. Là où la sécurité psychique, l’enveloppement maternel, les paroles, pour le petit ont manqué.
Ce sera une frustration légère, mais aussi, de façon plus insaisissable, un simple regard, un sourire ambigu, une intonation de voix chez une éducatrice, un geste sur l’épaule, qui jettera brutalement le trouble dans l’esprit de l’enfant.
Au-delà des propos éducatifs, l’adolescent observe, comme un tout petit, les expressions du visage de l’adulte; quelle figure maternelle originaire n’en finit pas d’être explorée, attendue, au-delà du manifeste? Cet agrippement de nourrisson au visage, à la voix, au corps de l’adulte est toujours là. Il est dans le regard, l’odeur parfois, la retenue des gestes, les bruits. Quelle place a-t-il, ce petit, cet infiniment faible, dans la préoccupation maternelle de l’adulte présent ? Va-t-il à nouveau être lâché, tomber dans l’oubli. L’âge actuel pour l’adolescent ne délivre pas de ces angoisses-là immémoriales ; celles de l’abandon psychique, d’un défaut d’inscription dans l’inconscient maternel.
Il n’en finit pas d’interroger chez l’adulte présent l’amour inconditionnel, le creux de l’espace matriciel de la mère …il faut avoir été fondamentalement accueilli, pour un jour consentir à se séparer et grandir en humanité.
Si un mouvement de régression, d’attachement, vient au jour, il convoque simultanément le maternel archaïque omnipotent, redoutable .Il n’y a plus alors que l’agression ou la fuite.
C’est là l’origine probable de certaines fugues compulsives, conduites d’évitement irrépressibles, entre impulsion meurtrière et peur de l’attachement.
C’est ainsi que toute émotion est menaçante, elle peut ouvrir les vannes d’une reviviscence autonome, imprévisible.
Ces adolescents n’arrivent pas à discerner la teneur des émotions qui peuvent les submerger ; entre attachement infantile massif et pulsion sexuelle violente. Ils disent qu’ils ont le diable en eux ; Ils disent de ces émotions qu’elles leur sont étrangères. Ils n’ont sans doute pas seulement le diable en eux, mais surtout les larmes en eux. Les leurs ou celles de leur mère… Et d’ailleurs, ils ne pleurent que rarement.
Des questions éthiques complexes.
Celui qui, enfant, a été pris , au delà de tout interdit, dans la jouissance aveugle des adultes , questionne sans cesse , par ses provocations inconscientes, l’éducateur ou le soignant en position tutélaire. C’est ainsi que le comportement pervers transitoire de certains adolescents vient interroger l’adulte à la racine de son choix professionnel. Il s’en trouve atteint dans son désir d’éthique et brutalement convoqué dans son discernement. L’approche de telles questions existentielles ne laisse pas indemne ; Le plus difficile, sans doute est de rencontrer chez ces jeunes cette dérision, ce persiflage, ces insultes et même cette séduction qui atteignent parfois jusqu’au secret de l’être.
Tout adulte , soignant ou éducateur, soumis à une incessante provocation, manipulé et fragilisé dans sa parole, court le risque de s’engouffrer dans un passage à l’acte violent envers un jeune. Il faut du discernement, du courage aussi pour se risquer à cette pratique éducative. La fonction tierce institutionnelle, la parole partagée, sont essentielles à cet endroit. C’est le seul recours, la référence première. Ce portage institutionnel est sans cesse troué et sans cesse réparé.Quels sont les repères fondamentaux et la légitimité de nos interventions dans ce contexte? Cette réflexion, si elle n’est pas menée, expose l’éducateur, tel une victime émissaire, aux conduites à risque de ces adolescents, en quête de sensations excitantes, de chocs émotionnels, comme d’une drogue.
Quelles conditions pour aborder cette clinique du Réel?
La clinique du réel désigne ce point où les capacités de l’imaginaire et du symbolique ne recouvrent plus les lieux de l’horreur. Cette clinique demande des conditions et des dispositifs d’élaboration psychique soutenus. Cela engage notre responsabilité de cliniciens, cela engage les choix institutionnels qui doivent être précisés.
La rencontre avec un autre, un « Autre « présent et incarné, comme peuvent l’être certains éducateurs, est cliniquement opérante. L’intime du vécu traumatique chez l’enfant vient au jour; vécu resté hors d’atteinte jusque-là. Cette manifestation est forcément douloureuse ; il faut pouvoir l’accueillir et non la rejeter brutalement; sinon nous sommes nous- mêmes, dans une posture perverse d’avidité curieuse qui ne soutient pas les conséquences d’une proposition d’accueil et d’écoute. C’est une explication plausible des exclusions répétitives que ces jeunes ont subies et qu’ils induisent dans les institutions ou les lieux de soin. On les dit « sans solution”.
En effet, après de telles expériences, ces garçons et ces filles demeurent psychiquement hors d’atteinte. Ils anticipent ces situations de rejet, les provoquent comme une addiction, une occasion de dissociation, en font un mode de survie, dans la défiance, sans repos ni sommeil.
Parfois, pourtant une éducatrice, un éducateur, trouve le passage vers l’un d’eux au moyen d’une parole véritablement incarnée, avec les gestes qui humanisent, y compris dans l’affrontement. Ces gestes là, tout le monde n’a pas la capacité de les risquer. Peut-on toujours puiser très loin en soi, dans sa propre vie psychique, dans son monde interne, pour entendre le trauma chez l’autre: c’est parce qu’il est lui même terrorisé , qu’un adolescent nous menace.
l’empreinte
Les adolescents, par leurs attaques incessantes , voudraient- ils ouvrir un creux en l’Autre, y laisser une encoche, une mémoire? Comment ont -ils été portés dans l’espace psychique, matriciel , de leur mère, elle même dans la tourmente, livrée à l’insécurité? Ce qu’ils cherchent , au-delà de la violence, c’est la possibilité d’une « empreinte » dans ce matériau primitif de leur vie psychique lorsque cette mémoire traumatique revient au jour.
Et lorsque reviennent les figures du passé, que s’entrouvre le plancher psychique, lorsque le nourrisson d’alors revient vers nous dans la violence et l’effroi de l’abandon passé, ce sont des bras contenants, des gestes fermes qui feront empreinte dans le psychisme en bordant ces aires traumatiques par des paroles soudain véridiques , mêlées aux mélopées ancestrales et aux bercements. Pourrait on parler là de greffe symbolique?
Mais est-il encore possible , avons- nous encore les moyens d’engager dans de telles prises en charges dans ce climat de raidissement?
La fonction paternelle de l’Etat?
Le statut expérimental de l’institution, ses prises de risque nécessaires , et son déficit budgétaire inévitable, ont suscité inquiétudes et évaluations par les organismes de contrôle . Mais peut -on juger de la pertinence d’une structure seulement à l’aune budgétaire , avec une logique comptable à court terme? Acceptons nous qu’il y ait de l’irréparable , non quantifiable, dans le malheur? Cette institution occupe fondamentalement une fonction d’ASILE, fonction dont semble t-il, faute de moyens, l’hôpital psychiatrique se démet pour cette frange de population parvenue à l’adolescence.
Habituellement, ces jeunes là sont maintenus dans l’errance, de lieux en lieux, jusqu’à leur majorité. Ils sont « réorientés » ou exclus à chaque acte délictueux, et finalement laissés dans la rue ou dans un hôtel de transit. Cette politique sociale ne fait que repousser la question qu’ils nous posent, à travers leurs symptômes, celle de l’acceptation par la société de leur existence.
La seule réponse alors, dans cette logique sécuritaire d’après coup, sera judiciaire. Ils chercheront, faute de mieux, par des conduites à risque, une probable incarcération avec les effets que l’on connaît sur des personnalités fragiles. La prison plutôt que l’hôpital.
« la chose publique »
La création d’une telle institution participe au Bien Commun, et relève fondamentalement de principes démocratiques. Il n’y a pas de mécénat privé. Son existence dépend de la volonté des gouvernants, des ARS, des Conseils Généraux, des ministères de la Justice , de l’Education Nationale.Cette institution renvoie aux instances gouvernementales une image rude. Elle met au jour et témoignage de la difficulté de prise en charge de ces jeunes , elle renseigne sur les possibilités de soin, et souligne les impasses. On a relevé dans les dossiers des négligences non seulement du côté des parents mais aussi du côté de ce qu’on nomme la fonction paternelle de l’état. Il y a donc une responsabilité partageable collectivement, au delà des parents directs, envers ces enfants victimes de maltraitance précoce, dont les agissements violents plus tard, témoignent.
Ces jeunes n’en finissent pas de crier au monde les effets néfastes d’une déliaison sociale et d’une attaque ordinaire de la possibilité de penser la complexité. Le simplisme de la logique binaire actuelle ne s’encombre pas de pensée clinique, ou anthropologique. Au nom d’un scientisme obscur, on croit possible une contention chimique de la violence, on prescrit trop vite des traitements psychotropes lourds aux jeunes enfants sans prendre le temps d’interroger le sens de leurs symptômes. Traitements qu’ils rejetteront dès l’âge de la majorité.
La violence du début de vie transmutée plus tard en conduite à risque addictive , dans une recherche de chocs émotionnels, engendrera de nouvelles violences à venir; celles que l’on connait maintenant dans les passages à l’acte tragiques suscités par des embrigadements sectaires.
Les adolescents dits « incasables » sont des témoins. Ils nous dévoilent la vision d’un nouvel ordre social en gestation et se présentent parfois comme les anges destructeurs d’un ordre ancien pour lequel la nostalgie n’est plus de mise.
Anne Costantini
Psychiatre psychanalyste
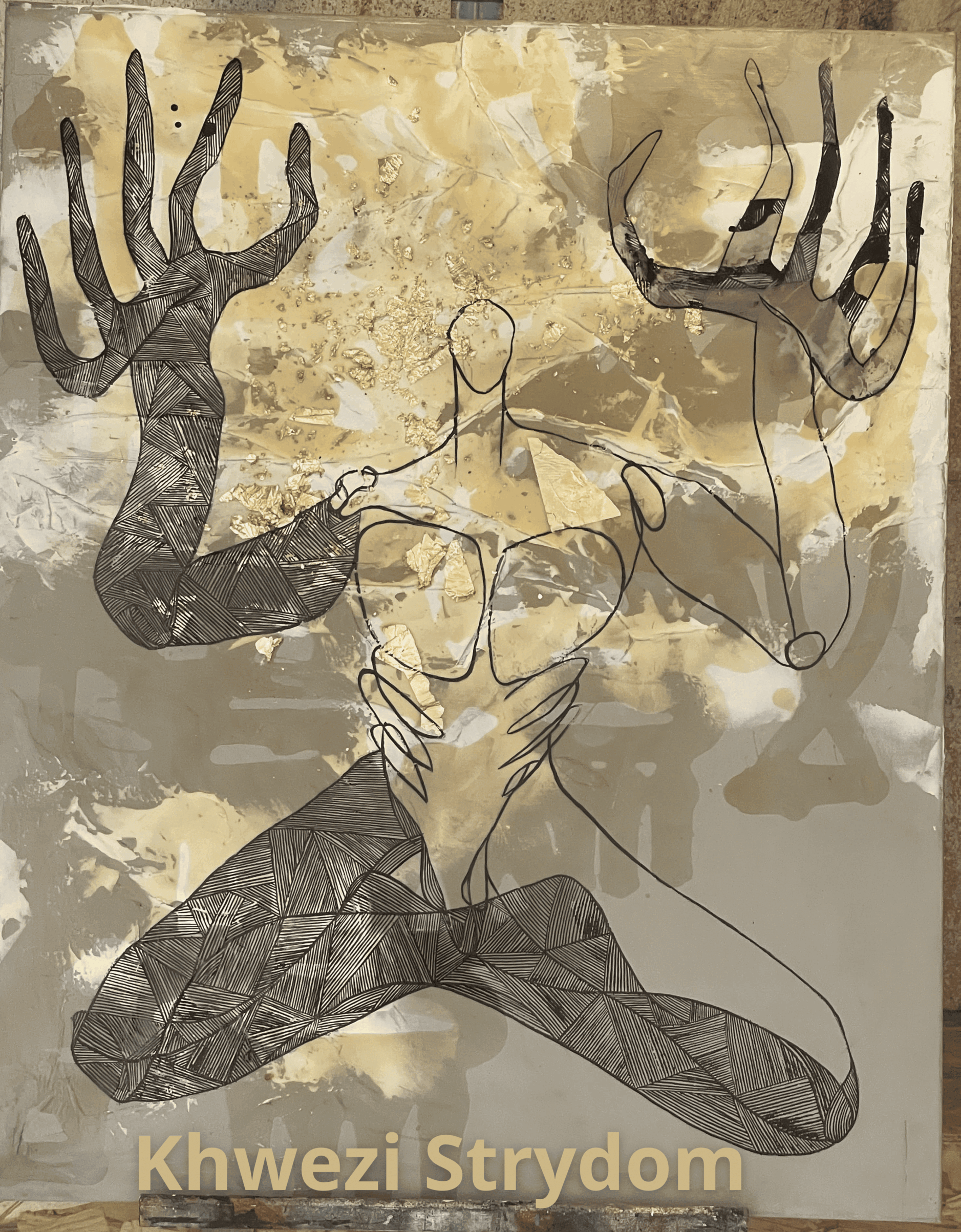
Laisser un commentaire